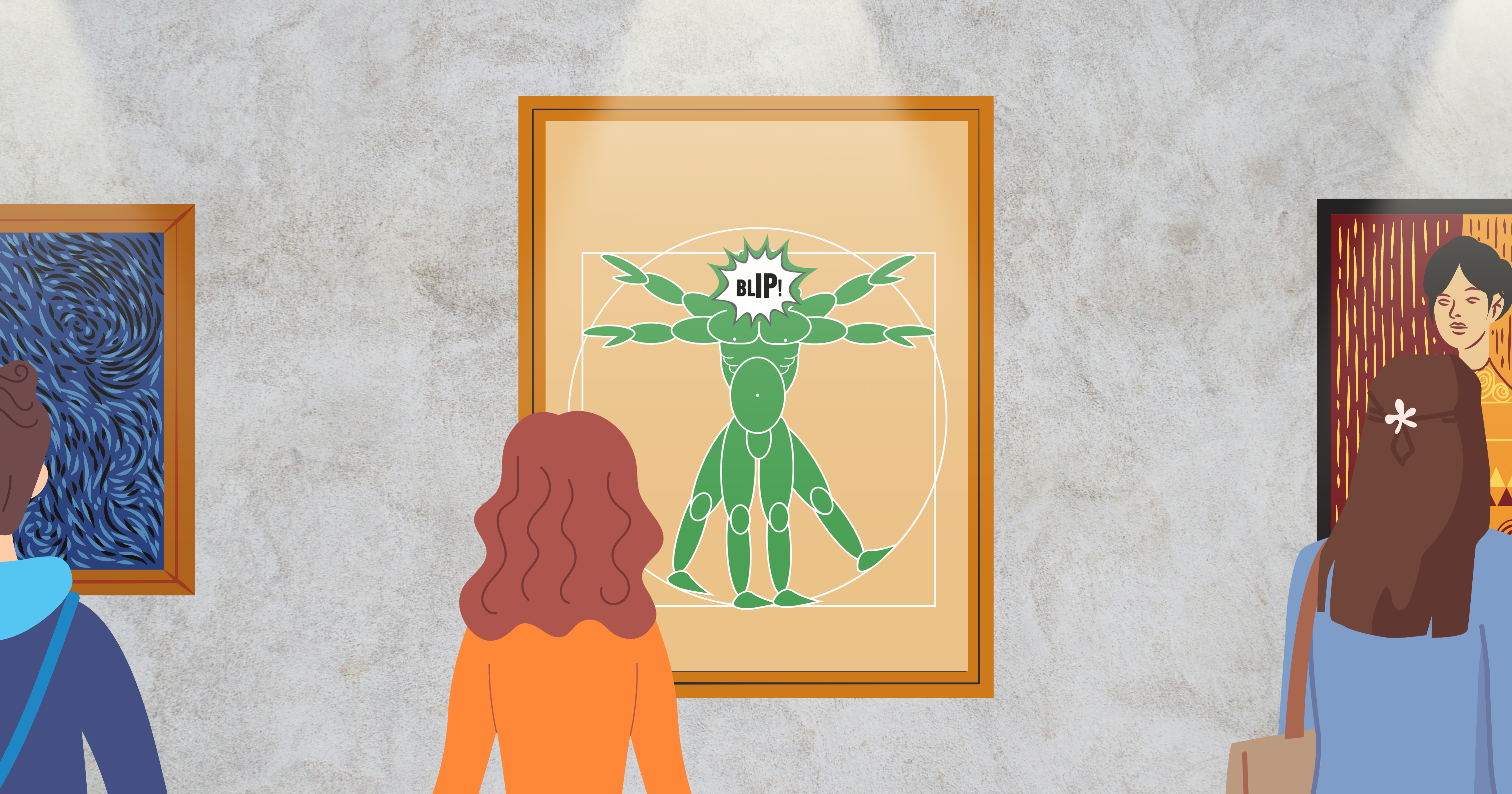« Leonardo réclame ses droits ! »
par Giulia Cortesi, Avocate aux Barreaux de Paris et de Rome et Associée au cabinet Kern & Weyl
Le 24 octobre 2022, une décision du Tribunal de Venise est venue confirmer l’illicéité de tout usage non autorisé à des fins commerciales d’une œuvre tombée dans le domaine public faisant partie du patrimoine culturel italien et protégée à ce titre.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas de violation de droits de propriété intellectuelle au sens strict, cette décision a le mérite de mettre en œuvre, pour la première fois, au-delà du territoire italien, les dispositions contenues dans le Code des biens culturels et du paysage (ci-également le « Code ») visant à protéger les biens du patrimoine culturel italien.
Les faits et la procédure
Les Galeries de l’Académie de Venise, ainsi que le Ministère de la Culture, s’étant aperçus que les sociétés Ravensburger commercialisaient un puzzle reproduisant l’Homme de Vitruve, célèbre dessin réalisé par De Vinci à la fin du XVème siècle, avaient introduit une procédure d’urgence devant le Tribunal de Venise afin de faire valoir un préjudice « grave et irréparable » du fait de:
- l’utilisation et la reproduction non autorisées et à but lucratif de l’image du célèbre dessin de Léonard de Vinci (préjudice économique);
- l’affaiblissement/la dilution de l’image du bien culturel (préjudice moral).
En effet, depuis 1822, les Galeries de l’Académie de Venise détiennent et conservent, sans l’exposer, le dessin original de De Vinci tout en présentant au public de nombreuses copies.
Or, les requérantes, en application de l’article 108 du Code, prétendaient, en leur qualité d’institution ayant la charge de la garde du dessin de l’artiste, avoir le pouvoir exclusif d’autoriser la reproduction de l’œuvre et avoir droit aux redevances relatives à sa reproduction par tout tiers, redevances qui, d’après ledit article 108 du Code, sont déterminées par le sujet ayant la charge du bien culturel et qui sont à verser annuellement et en avance en tenant compte notamment :
(a) de la nature des activités auxquelles se rapportent les concessions d’utilisation ;
(b) des moyens et des modalités d’exécution des reproductions ;
(c) du type et du temps d’utilisation des espaces et des biens ;
(d) de l’utilisation et de la destination des reproductions, ainsi que des avantages économiques qui en découlent pour le bénéficiaire de l’autorisation.
En l’espèce, la requérante avait calculé son préjudice en appliquant une redevance égale à 10 % des recettes de Ravensburger, depuis le début de la commercialisation en 2019 pour un total d’environ 1.000 puzzles vendus.
S’agissant de la notion de « bien culturel », l’article 2, paragraphe 2 du Code précise que les biens culturels sont les biens immobiliers et mobiliers qui, selon les articles 10 et 11, présentent un intérêt artistique, historique, archéologique, ethno-anthropologique, archivistique et bibliographique, ainsi que d’autres biens identifiés par la loi ou sur la base de la loi comme étant des témoignages de l’héritage culturel italien.
Ainsi, il aurait été difficile de nier la qualité de bien culturel de l’Homme de Vitruve !
En défense, les sociétés Ravensburger avaient soulevé une exception d’incompétence en faveur des juges allemands pour les deux sociétés défenderesses de droit allemand et en faveur du Tribunal de Milan pour la filiale italienne et soutenu au fond que :
- l’œuvre objet de reproduction était tombée dans le domaine public ;
- la réglementation contenue dans le Code serait un « unicum international », à savoir une exception italienne ayant nécessairement une application limitée au territoire national ;
- l’obligation de paiement d’une redevance ne pouvait pas concerner l’activité de commercialisation en dehors du territoire italien, cette prévision étant contraire à la Directive CE 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ;
Le Tribunal de Venise, par une ordonnance du 20 juin 2022, avait rejeté la requête des Galeries de l’Académie de Venise et du Ministère de la Culture in limine litis en déclarant son incompétence en faveur du Tribunal de Milan.
Dans ces conditions, les requérantes avaient contesté l’ordonnance dans le cadre d’un « reclamo » devant le Tribunal de Venise, soit la voie de recours propre aux décisions préventives et d’urgence en Italie.
La décision
Premièrement, le Tribunal de Venise a statué sur les fins de non-recevoir en déclarant compétente la juridiction italienne, celle-ci étant la juridiction du lieu dans le ressort de laquelle le dommage avait été subi.
En effet, les juges ont notamment considéré que, même si la commercialisation avait eu lieu en dehors de l’Italie, le préjudice final avait été subi là où le bien culturel était physiquement localisé.
Deuxièmement, le Tribunal de Venise a statué sur la compétence territoriale en affirmant sa propre compétence et rejetant celle du Tribunal de Milan, Venise étant le lieu où les conséquences préjudiciables, de nature économique et morale, s’étaient manifestées.
Le Tribunal a ensuite tranché la question de la loi applicable, à savoir l’application de la loi italienne en matière de protection des biens culturels en présence d’éléments d’extranéité, ici la nationalité allemande de deux défenderesses sur trois, ainsi qu’une commercialisation n’étant pas limitée au territoire italien.
Les juges italiens ont confirmé l’application à l’espèce des règles issus du Code des biens culturel en mettant en avant l’existence de liens les plus étroits avec l’Italie, pays dans lequel : i) les conséquences préjudiciables s’étaient produites : ii) le bien culturel était gardé ; iii) le siège de l’administration chargé de la garde du bien était localisé.
De plus, le Tribunal a considéré que le Code devait être qualifié de « loi de police », à savoir une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application.
A cet égard, les juges ont précisé que :
« Le Code italien représente un unicum au niveau européen précisément parce qu’en l’adoptant, le législateur a voulu protéger au mieux un intérêt considéré comme essentiel pour l’État italien (connu dans le monde entier pour son immense valeur artistique et culturelle, reconnue par l’article 9 de la Constitution) ».
La justification de l’extension aux sociétés allemandes des obligations découlant du Code des biens culturels a été fondée par les juges également par la présence d’un « lien économique fonctionnel existant entre les sociétés du même groupe, ayant le même projet et finalité d’entreprise » ; ce qui a engendré, selon les juges vénitiens, une participation au même titre des trois sociétés du groupe dans l’exploitation commerciale non autorisée de l’œuvre de De Vinci.
Venant aux faits litigieux, le Tribunal a considéré que les sociétés Ravensburger avaient reproduit l’image et le nom de l’Homme de Vitruve sans l’autorisation des Galeries de Venise, et ce dans un but lucratif, sans verser à l’Administration les redevances dues pour l’exploitation commerciale et publicitaire.
Aussi, les juges vénitiens ont :
- interdit aux sociétés Ravensburger son utilisation sur tout produit et support même numérique;
- fixé une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance par le groupe allemand ;
- ordonné la publication de la décision.
Commentaires
La décision du Tribunal de Venise fait suite à une série de décisions du Tribunal de Florence, qui avaient déjà eu l’occasion d’appliquer les règles précitées, afin de garantir à la Galerie de l’Académie de Florence la protection contre toute utilisation non autorisée et dégradant l’image de la statue du célèbre David de Michelangelo.
Ces décisions suscitent des réflexions sous différents angles.
Premièrement, au regard du droit de la propriété intellectuelle, nous pouvons nous questionner sur l’articulation entre le droit d’auteur et la protection issue du Code des biens culturels, notamment d’un point de vue temporel.
L’article 12 du Code prévoit que seuls sont protégeables les biens ayant un intérêt culturel « qui sont l’œuvre d’un auteur qui n’est plus en vie et dont la création a plus de 70 ans ».
Or, le droit d’auteur est protégé pendant 70 ans après la mort de l’auteur, alors que le point de départ de la protection en tant que bien culturel débute 70 ans après la création de l’œuvre.
Il s’ensuit que, dans quelques rares cas, le droit d’auteur pourra coexister avec la protection du bien culturel.
Ceci obligerait donc celui qui souhaiterait exploiter l’image ou le nom de l’œuvre, à être autorisé à la fois par les ayant droits de l’auteur et par l’entité ayant la garde de l’objet, ainsi qu’à payer les redevances dues au titre du droit d’auteur et de l’article 108 du Code.
Ensuite, si nous admettons qu’il existe une certaine proximité entre la protection conférée par le droit d’auteur et celle garantie par le Code des biens culturels (prérogatives morales et patrimoniales), on pourrait considérer, comme les sociétés Ravensburger l’ont soutenu, que la protection du bien culturel viendrait de facto empêcher que certains œuvres tombent dans le domaine public.
En d’autres termes, on assisterait à un prolongement perpétuel de la protection pour les œuvres dont la valeur aurait été préalablement reconnue par le Ministère de la Culture italien.
On peut imaginer que l’œuvre passe d’un régime de « titularité » à un régime de « tutelle », son exploitation restant subordonnée à autorisation.
Deuxièmement, nous pouvons analyser cette décision d’un point de vue politico-économique.
La décision du Tribunal de Venise, ainsi que les précédents florentins, ont le mérite d’avoir transmis un message politique important en criant haut et fort que la protection du patrimoine culturel et la guerre contre la « marchandisation » de la culture sont au cœur des intérêts de l’État italien et dont le fondement est Constitutionnel.
Cependant, les Juges de Venise, en imposant l’obligation d’autorisation et de contribution des redevances, même à des sociétés étrangères, et pour une exploitation ayant eu lieu en partie en dehors du territoire italien, défendent un argument qui n’est pas étranger à une logique mercantiliste de l’art.
En effet, on retrouve la nécessité de continuer à exploiter les œuvres ayant un intérêt culturel, cette fois-ci en faveur des musées et fondations (privés et ecclésiastiques) sans but lucratif ; institutions de plus en plus abandonnés par l’État italien.
Espérons donc qu’à l’avenir la protection conférée par le Code des biens culturels soit davantage utilisée pour prévenir et arrêter tout usage dégradant des images mythiques du patrimoine culturel italien.
Il serait en effet regrettable que cette protection vienne à restreindre la circulation vertueuse d’œuvres faisant désormais partie du patrimoine artistique universel tombé dans le domaine public, et ce en raison d’exigences de trésorerie !
Enfin, nous mettons en garde les futurs exploitants (notamment étrangers) d’images appartenant au domaine culturel italien, afin qu’ils redoublent d’attention.
En effet, d’un point de vue pratique, il sera nécessaire de contacter l’institution ayant la garde de l’objet afin de convenir de redevances dans l’hypothèse où la qualité de « bien culturel » aurait été déjà déclaré par le Ministère.
« Leonardo réclame ses droits ! », par Giulia Cortesi, Avocate aux Barreaux de Paris et de Rome et Associée au cabinet Kern & Weyl