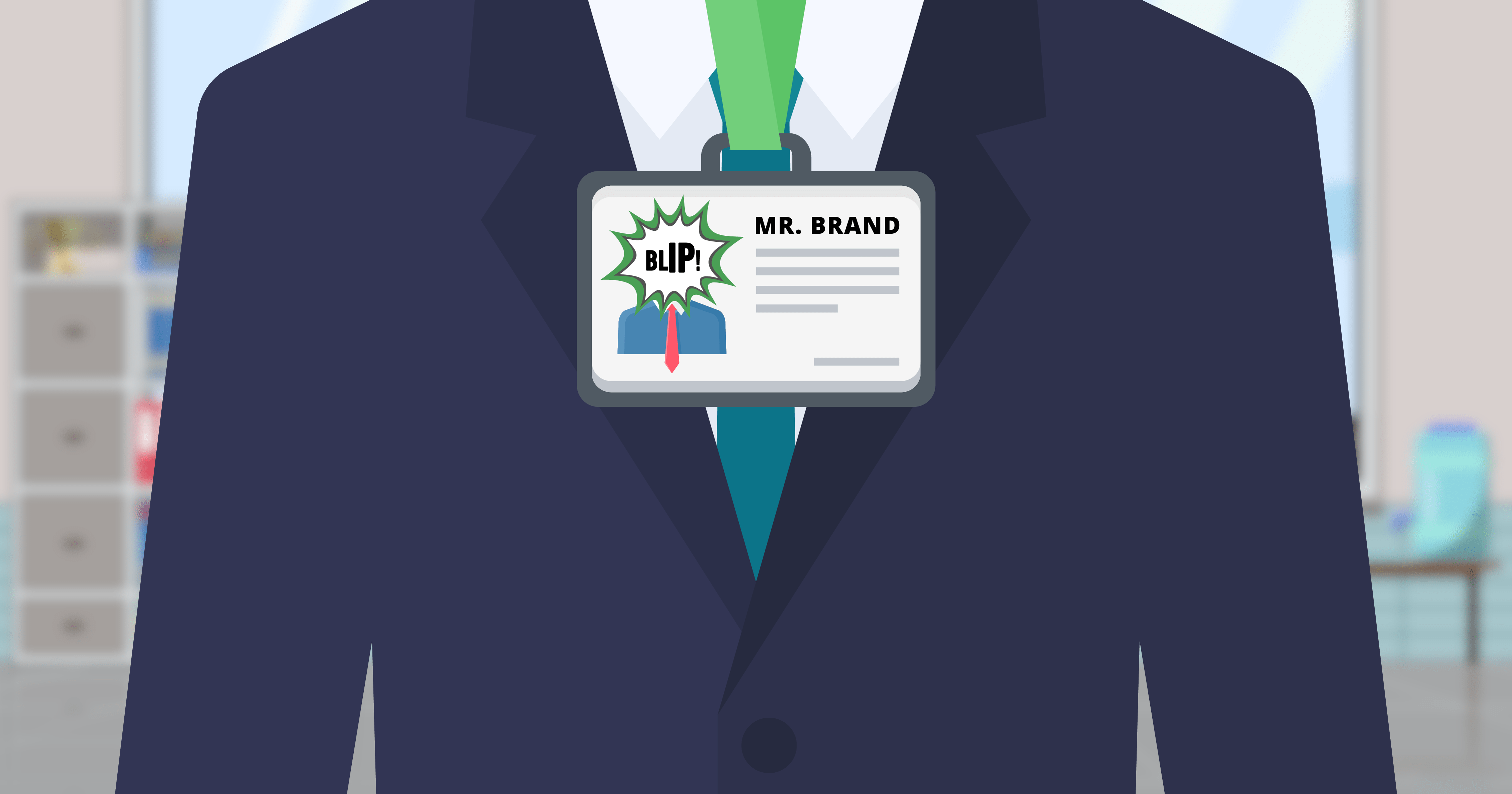Affaire de Castelbajac : du nouveau pour les marques patronymiques ?
par Yann Basire, Maître de conférences en droit privé, Directeur général du CEIPI, Membre du Laboratoire de recherche du CEIPI (UR 4375)
Le 22 octobre dernier, la Cour d’appel s’est prononcée dans le cadre d’un « énième » contentieux relatif aux marques composées du nom de famille de Castelbajac (CA Paris, 12 oct. 2022, RG 20/11628). Bien qu’il soit passé quelque peu inaperçu, l’arrêt mérite une attention particulière en ce qu’il reconnaît, contrairement aux préceptes dégagés par la Cour de justice (CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Florence Émanuel), qu’une marque composée d’un nom de famille pouvait être déceptive. Ce faisant, la Cour d’appel de Paris réhabilite la possibilité pour le porteur d’un nom de famille d’obtenir la déchéance d’une marque reprenant ce patronyme, dès lors que celui-ci n’exerce plus de fonctions au sein de la société titulaire de celle-ci.
Afin de comprendre comment les juges du fond sont arrivés à une telle conclusion, il convient de revenir sur les faits de l’espèce.
Le contexte
À l’occasion d’un conflit l’opposant à la société PMJC, M. Jean-Charles de Castelbajac avait sollicité reconventionnellement la déchéance des marques verbales JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC. Celles-ci avaient été cédées, le 3 février 2012, suite au redressement judiciaire de la société Jean-Charles de Castelbajac dirigée par M. Jean-Charles de Castelbajac, à la société PMJC. Parallèlement à cela, M. Jean-Charles de Castelbajac avait signé un « protocole de prestation de services » avec cette société. Ce protocole insistait sur la « nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image » de M. de Castelbajac, qui s’était vu confier à cette occasion la mission de directeur artistique. Une fois ce protocole arrivé à son terme, des difficultés sont apparues entre les parties, le créateur reprochant au titulaire de la marque d’avoir développé un modèle économique consistant à imiter l’univers et les dessins de son ancien directeur artistique, notamment dans le cadre de partenariats conclus avec des entreprises tierces, portant sur des adaptations non autorisées de ses œuvres. De son côté, M. de Castelbajac créa la société Castelbajac Creative qui avait pour activité la création d’œuvres, la prestation de conseils et de services de direction artistique.
C’est dans ce contexte que de nombreuses actions ont été diligentées, la société PMJC reprochant, notamment, à M. de Castelbajac, par l’intermédiaire de sa nouvelle société, de se livrer à une concurrence déloyale et de porter atteinte aux marques De Castelbajac dont elle est titulaire. Pour sa part, M. de Castelbajac, considérant qu’il était fait un usage déceptif de ces marques, demanda leur déchéance. Si cette demande fut rejetée par le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 26 juin 2020, RG n° 18/07891), elle fut, à l’inverse, accueillie favorablement par la Cour d’appel de Paris.
Garantie d’éviction et recevabilité de l’action en déchéance
Avant d’envisager le caractère déceptif des marques litigieuses, les juges du fond devaient se prononcer sur la recevabilité de l’action en déchéance, la société PMJC ayant invoqué son irrecevabilité en raison de la garantie d’éviction du cédant.
L’argument invoqué par le titulaire de la marque, consistant à considérer la demande en déchéance irrecevable, n’est en rien nouveau. En effet, dans un arrêt rendu à propos des marques Inès de la Fressange, la Cour d’appel de Paris s’illustra en reconnaissant qu’une marque patronymique était devenue déceptive suite au licenciement d’Inès de la Fressange, justifiant ainsi de prononcer la déchéance de la marque concernée, conformément à l’article L. 714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 15 déc. 2004, PIBD 2005, n° 803, III, p. 142). La Cour de cassation censura, toutefois, cette analyse au visa de l’article 1628 du Code civil, le cédant des marques litigieuses « n’étant pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. Com. 31 janv. 2006, n° 05-10.116). Il était, dès lors, logique d’attendre de la Cour d’appel de Paris qu’elle déclare irrecevable, dans la présente espèce, la demande en déchéance de M. de Castelbajac. Tel n’est pourtant pas le cas : confirmant en cela la position du Tribunal judiciaire, la Cour d’appel note que le manquement à la garantie d’éviction ne constitue pas une irrecevabilité à agir, mais constitue une faute distincte susceptible d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1630 du Code civil. Outre le fait qu’elle contredise la jurisprudence de la Cour de cassation, la solution appelle ici quelques réserves.
Il est vrai que l’article 1630 du Code civil, relatif aux sanctions attachées à la garantie d’éviction du cédant, est silencieux quant au sort à réserver aux actions judiciaires troublant la jouissance paisible du cessionnaire. La Cour d’appel opère donc une lecture littérale de cette disposition, afin d’en conclure que l’action en déchéance du cédant ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir.
Pour autant, faut-il voir dans l’irrecevabilité d’une action en déchéance une sanction de la garantie d’éviction ? Une réponse négative s’impose. En réalité, l’irrecevabilité est induite de la garantie d’éviction et s’apparente à une conséquence de celle-ci. Le principe est connu : en excipant une fin de non-recevoir, un défendeur dénie au demandeur le droit d’agir. Il s’agit, dans le contexte du droit des marques, de l’objectif poursuivi par le cessionnaire d’une marque voyant celle-ci contestée par le cédant. La garantie du fait personnel implique que le cédant s’abstienne de tout acte qui apporterait un trouble dans la jouissance du droit transféré à l’acheteur (N. Mathey, « Vente commerciale – Obligations du vendeur – Garantie d’éviction », JCl Contrats – Distribution, Fasc. 320, 2016, n° 5). C’est ainsi que le vendeur qui doit garantie ne peut évincer, lui-même, l’acquéreur en agissant en justice afin d’anéantir le droit qu’il a cédé. La garantie d’éviction prive, alors, le cédant d’un quelconque droit d’agir à l’encontre du cessionnaire. Le fait d’opposer une fin de non-recevoir à l’opérateur qui tenterait de remettre en cause l’existence d’une marque qu’il aurait précédemment cédée en constitue donc la conséquence juridique. Il convient, par ailleurs, de préciser que les prétentions qui seraient contraires à l’ordre public ont vocation à être rejetées sans examen au fond (N. Cayrol, « Action en justice », Rép. Dalloz, Procédure civile, 2019, n° 262). Or, la garantie du fait personnel étant d’ordre public, toute action diligentée par le cédant ayant pour conséquence de tenter d’évincer le cessionnaire se doit d’être déclarée irrecevable. La solution ne semblait pas faire débat jusqu’à cet arrêt de Castelbajac, la jurisprudence ayant affirmé à de nombreuses reprises qu’une action en déchéance – pour défaut d’exploitation (TGI Paris, 16 déc. 1998, LPA 31 août 2000, p. 11) ou pour cause de déceptivité (Cass. Com. 31 janv. 2006, n° 05-10.116) – menée par le cédant d’une marque à l’encontre du cessionnaire devait être déclarée irrecevable au visa de l’article 1628 du Code civil.
Un autre argument aurait pu, en réalité, être retenu par la Cour d’appel de Paris. Dans son commentaire de l’arrêt Inès de la Fressange, le Professeur Gautier rappelle qu’il « est admis que lorsque la cause d’éviction repose dans un motif d’ordre public, telle une nullité absolue, l’utilité sociale justifie que tout intéressé, vendeur compris, puisse exercer l’action » (P.-Y. Gautier, « « Qui doit garantie ne peut évincer » ? Pas forcément », RTD Civ. 2006, p. 339 citant à l’appui de cette assertion : M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, 2e éd. t. X, par J. Hamel, n° 90). Il ajoute que la déceptivité constituant un « motif d’ordre public », l’irrecevabilité de la demande en déchéance « n’était pas aussi évidente que cela » (Ibidem). En tant qu’exception au principe de libre concurrence, le droit de marque se doit d’être strictement encadré afin qu’il n’y soit pas trop attentatoire. C’est la raison pour laquelle sont, notamment, refusés à l’enregistrement les signes génériques ou descriptifs, ainsi que les formes de produit nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. La prohibition des marques déceptives participe de cette même logique, en ce qu’elle évite que le droit de marque puisse constituer un instrument déloyal de captation de la clientèle (V. l’arrêt Inès de la Fressange). Or, un instrument loyal d’information des consommateurs contribue à assurer la loyauté sur le marché, afin d’éviter de fausser le jeu de la libre concurrence. C’est donc la protection des concurrents – et non celle du consommateur – qui légitimerait les dispositions portant sur les marques déceptives. En ce sens, elles répondraient à une logique d’ordre public économique, susceptible de dépasser l’écueil de l’irrecevabilité de l’action en déchéance du cédant.
L’usage déceptif du nom de famille : un arrêt contraire à la jurisprudence de la Cour de justice ?
Au-delà de ces critiques, l’action étant jugée recevable, la Cour d’appel continua son analyse en s’attachant à appréhender la question de l’usage déceptif de la marque. Là encore, le raisonnement étonne. La société PMJC rappelle, à bon droit, que dans des affaires similaires à la présente espèce, aucun demandeur à une action en déchéance n’est parvenu à faire juger qu’une marque composée d’un nom de famille était devenue déceptive en raison des conditions de son exploitation lorsque le porteur du nom en question n’exerce plus de fonction au sein de la société titulaire de la marque. La question avait même été tranchée en 2006 par la Cour de justice (CJCE 30 mars 2006, préc). Dans cette affaire, la Cour de justice interrogée tant sur la déceptivité en tant que motif absolu de refus ou de nullité, que sur la déceptivité en tant que motif de déchéance, releva que si un consommateur moyen pouvait être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque Elizabeth Émanuel, en imaginant que le porteur de ce nom avait participé à la création de ce vêtement, il n’en demeurait pas moins que les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restaient garanties par l’entreprise titulaire de la marque. En conséquence, la dénomination Elizabeth Émanuel ne pouvait être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désignait (Pts. 49 et 50). En d’autres termes, l’influence exercée par le nom de famille serait insuffisante pour caractériser la tromperie dans l’hypothèse où son porteur n’a plus de lien avec le titulaire de la marque patronymique. Plus encore, la Cour de justice n’hésita pas à affirmer que le fait pour le titulaire de la marque de tenter, sciemment, de faire croire au consommateur que le porteur du nom de famille est toujours actif au sein de l’entreprise, constituait une manœuvre dolosive ne pouvant pas être analysée comme une tromperie au sens de la Directive marque (Pt. 50). Au regard de telles affirmations, il semble difficile, si ce n’est impossible, pour une juridiction nationale, de caractériser l’usage déceptif d’une marque composée d’un nom de famille. L’obstacle ne fut pourtant pas insurmontable pour la Cour d’appel de Paris.
Les juges du fond indiquent, en premier lieu, que la problématique ne serait pas liée au fait que M. de Castelbajac n’exerce plus les fonctions de directeur artistique au sein de la société PMJC, mais que l’usage des marques litigieuses est opéré dans de telles conditions qu’il serait de nature à persuader le consommateur que les produits portant ces marques ont été conçus sous la direction artistique de M. de Castelbajac. Ils renvoient ensuite à la conclusion de la Cour de justice qui avait dit pour droit que « Le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus » (la Cour souligne). Ainsi, pour la Cour d’appel, la solution de la Cour de justice n’exclut pas de pouvoir reconnaître qu’une marque patronymique puisse faire l’objet d’un usage déceptif et, partant, que celle-ci puisse être sanctionnée au titre de la déchéance, dès lors que des manœuvres dolosives peuvent être constatées.
La Cour d’appel recense, ensuite, l’ensemble des circonstances susceptibles de générer une confusion dans l’esprit du consommateur. Elle note, d’une part, que la société PMJC, en collaboration avec d’autres sociétés, avait proposé à la vente des collections reprenant les éléments emblématiques de l’univers de M. de Castelbajac et à l’occasion desquelles les marques litigieuses avaient été utilisées. Ces collections avaient, non seulement, donné lieu à des commentaires sur de nombreux sites internet relayant l’idée selon laquelle les produits avaient été élaborés dans le cadre d’un partenariat avec M. de Castelbajac, mais aussi d’articles promotionnels mettant expressément en avant l’existence d’une collaboration avec le créateur. Le titulaire lança, en outre, une campagne promotionnelle afin de célébrer le cinquantenaire du travail de M. de Castelbajac, campagne ayant, par ailleurs, fait l’objet d’une transaction avec M. de Castelbajac. A cela, s’ajoutent les nombreuses décisions (V. notamment, CA Paris, pôle 5, ch. 2, 1er mars 2019, RG n° 18/18865 ; CA Paris, pôle 5, ch. 1, 7 sept. 2021, RG n° 19/13325) ayant reconnu que la société PMJC avait porté atteinte aux droits d’auteur de M. de Castelbajac, en reprenant dans le cadre d’opérations commerciales des œuvres du créateur. La Cour d’appel conclut qu’il s’agit là d’agissements faisant croire au consommateur que les produits revêtus de ces signes ont été conçus par ou sous la direction de M. de Castelbajac, justifiant que soit prononcée la déchéance des droits du titulaire.
Il est vrai que les circonstances de l’espèce donnent difficilement tort à la Cour d’appel de Paris, le titulaire des marques litigieuses ayant entretenu le flou quant à ses relations avec M. de Castelbajac. Pour autant, et en dépit de l’abondance des circonstances susceptibles de conduire au constat de la déceptivité, la conformité de cette décision avec la jurisprudence de la Cour de justice interroge. Il semble que le postulat de départ, selon lequel la conclusion de la Cour de justice était limitée aux circonstances de l’espèce, repose, malheureusement, sur une vision parcellaire de l’arrêt Elizabeth Emanuel.
La Cour de justice avait, comme nous l’avons rappelé, envisagé et rejeté l’hypothèse des manœuvres dolosives du champ de la déceptivité au sens de la Directive marque. Plus encore, elle a affirmé, sans ambiguïté, qu’une marque composée d’un nom de famille ne pouvait pas être de nature à tromper le public sur l’une des qualités du produit désigné. Dès lors, et nonobstant les conditions d’exploitation de la marque patronymique, la déchéance pour cause de déceptivité ne devrait pas pouvoir lui être opposée. Il sera, en tout état de cause, intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence française sur la question. Bien qu’il puisse être critiqué à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, mais aussi s’agissant de l’application de la garantie d’éviction, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris n’en demeure pas moins particulièrement intéressant, en ce qu’il invite à réouvrir le débat relatif aux marques patronymiques.