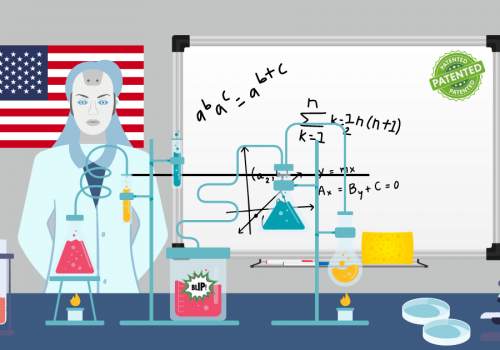La réappropriation artistique en question en droit américain et en droit français
un article de Carolle Sanchez, avocate aux barreaux de Paris et New York
La question de la réappropriation d’une œuvre existante est un sujet très fréquent dans la création. L’histoire de l’art est nourrie de ces reprises qui ont permis, notamment, de repenser la question de l’originalité et de la paternité d’une œuvre. Aujourd’hui, cette question est d’autant plus importante que l’essor des technologies numériques, avec celui de l’Intelligence Artificielle, permet de créer de nouvelles œuvres à partir d’une base créative existante.
Fréquentes dans l’histoire de l’art, les réappropriations posent question au regard du droit. Dans certains cas, ces œuvres, consistant en une simple répétition, interprétation ou révision sans autorisation, pourraient être remises en cause par les tribunaux si la question était soulevée devant eux. De fait, le milieu de l’art perçoit souvent la protection par le droit d’auteur ou le copyright américain comme un frein à la création. En effet, ces droits accordent un puissant outil de protection pour les titulaires de droit et limitent les possibilités de réappropriations. De cette tension entre liberté d’expression créative et protection, découle une forme de suspicion envers la matière juridique et les décisions rendues (Michel Guerrin, « Un procès autour d’Andy Warhol pourrait avoir de rudes conséquences pour les musées et l’avenir de l’art » in Le Monde, 10 mars 2023).
Toutefois, loin d’être le cas, les droits de propriétés intellectuelles constituent une matière qui se travaille en fonction de leurs contextes. En l’absence d’harmonisation des règles de droit entre la France et les Etats-Unis, les artistes doivent faire le tri et raisonner avec les bons outils selon les intérêts français ou américains en présence. A la faveur du récent arrêt de la Cour suprême (AWF, Inc. v. Lynn Goldsmith et al., US 598 (2023)) dont l’écho a été retentissant tant aux Etats-Unis qu’en France, il est utile de comparer les rouages et les mécanismes à l’œuvre, tant aux Etats-Unis qu’en France, dans la tentative d’équilibre entre liberté de la création et protection des œuvres existantes.
Le droit américain : copyright et les contours flous du fair use
Le droit d’auteur américain est un droit fondé sur les principes tirés de sa jurisprudence (Common Law) qui ont été codifiés dans le Copyright Act de 1790 puis de 1976. Par un mécanisme de récompense, le Copyright Act vise à encourager la créativité en reconnaissant à l’auteur•rice des droits exclusifs tels que le droit de reproduction, le droit de créer des œuvres dérivées et le droit de représentation (Article 106 du Copyright Act). Toutefois, au sein de ce même appareil législatif, s’opère également une balance des intérêts entre deux impératifs : (i) celui de promouvoir la création en octroyant des droits exclusifs aux auteur•rices et (ii) celui de ne pas étouffer la création, ni la liberté des utilisateurs en favorisant la circulation et la réutilisation des œuvres. Si les intérêts des auteurs et la créativité sont protégés, leur corollaire – les intérêts des utilisateurs et la circulation des œuvres – est également défendu par le principe du fair use dont les critères jurisprudentiels ont été codifiés (l’article 107 du Copyright Act de 1976).
Le Fair use est une limitation portée au copyright qui, pour être applicable, doit répondre à quatre facteurs :
- L’objectif et caractère de l’usage, en vérifiant si l’usage est à des fins commerciales ou éducatives non lucratives ;
- La nature de l’œuvre protégée ;
- L’ampleur de la partie utilisée comparée à l’ensemble de l’œuvre protégée ;
- L’effet de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée.
Afin de savoir si l’exception est valablement revendiquée, les tribunaux américains procèdent à l’analyse de chaque facteur in concreto avant d’opérer une balance des intérêts entre le fair use revendiqué et l’œuvre protégée.
Une telle analyse par essence totalement ouverte n’est pas évidente : « le constat est fait depuis longtemps aux Etats-Unis même, relevant que la doctrine du fair use est “the most troublesome in the whole copyright law” ». Pour preuve, les divergences qui ont opposé les 2e et 9e circuits de la Cour d’appel pour définir « l’usage transformatif »
– épineuse question qui ressort de l’étude du premier facteur -, et qui n’ont pas permis d’aboutir à une grande sécurité juridique sur les possibilités de reprise et de réappropriation à l’intérieur du Copyright Act.
Dans le cadre de l’arrêt de la Cour Suprême du 18 mai 2023 opposant the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (ci-après « la Fondation ») à Lynn Goldsmith (AWF, Inc. v. Lynn Goldsmith, prec.), photographe connue du milieu musical pour ses portraits de rock stars, la Cour a en effet dû répondre à cette lancinante question des contours d’une « œuvre transformatrice », question qui a émaillé la jurisprudence américaine, donnant lieu à des définitions plus ou moins claires de ce large concept d’effet transformatif d’un travail artistique ou musical (Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. US 510 (1994)). Le récent arrêt de la Cour Suprême même s’il tente une définition très étayée de « l’œuvre transformatrice » n’est pas épargné par l’écueil d’un système qui offre en réalité beaucoup trop de « zones d’ombres » (André Lucas, Fasc.1248 : Droits des auteurs – Droits patrimoniaux, Lexis-Nexis, §31).
Au long des débats judiciaires, la question a été de déterminer si l’œuvre d’Andy Warhol dénommée Orange Prince publiée dans la revue Vanity Fair était suffisamment transformatrice pour en faire une œuvre secondaire exclusive de l’accord de l’auteur initial. Sur ce point, l’arrêt a le mérite de rééquilibrer le jeu du pouvoir symbolique qui peut se jouer entre artistes dont les degrés de célébrité peuvent varier : excluant le « celebrity-plagiarist privilege » (AWF, Inc. v. Lynn Goldsmith, prec., p.11), la Cour considère que la seule empreinte reconnaissable d’Andy Warhol sur la photographie originale ne peut à elle seule suffire à qualifier le travail de ce dernier d’ « œuvre transformatrice ».
En outre, la Cour observe que l’utilisation faite de Orange Prince pour illustrer les magazines sur la vie et la mort de Prince correspond en tout point à la destination de la photographie de Lynn Goldsmith. Dès lors, la Fondation ne pouvait se prévaloir d’aucune différence entre les objectifs et le sens de la publication faite par la Fondation par rapport à l’original. Une telle conclusion reviendrait-elle à dire que l’utilisation des seize œuvres de la série Prince à des fins de conservation ou d’exposition par les collections privées ou par le musée Andy Warhol serait tolérée, sans qu’il soit utile de préciser l’œuvre de référence ni le copyright de Lynn Goldsmith ?
Sur ce point, la Cour n’a exprimé aucune opinion puisqu’elle a limité son analyse à la seule cession de droits de Orange Prince à la revue Vanity Fair. Il est toutefois permis de le penser. Rappelons, en effet, que l’utilisation à des fins de publication dans une revue commerciale et la cession rémunérée de ces portraits par la Fondation sont des points centraux de l’arrêt. La Cour note à cet égard que la Fondation a vendu la publication du portrait 10.000 dollars à la société Condé Nast sans reverser un cent à Lynn Goldsmith. Elle fait de la destination et du caractère commercial, un élément essentiel de son raisonnement en défaveur de la Fondation.
Partant, les seize œuvres d’Andy Warhol pourraient toujours vivre des jours paisibles sous le régime flexible du fair use. Une note de bas de page de l’arrêt de la Cour d’appel dans cette affaire est en cela intrigante : la Cour note s’agissant des injonctions qui auraient pu être ordonnées : « Goldsmith does not seek such remedies, and it is highly unlikely that any court would deem them appropriate in this case. See Campbell, 510 U.S. at 578 n°10 ( the goals fo the copryright law…are not always best served by automatically granting injunctive relief when parodists are found to have gone beyond the bounds of fair use.) » (AWF, Inc. v. Lynn Goldsmith et al., 992 F ; 3rd 99 (2d circuit, 2021))
Il va sans dire que le droit français en la matière est autrement moins tolérant.
Le droit français : le principe et la rigueur de ses exceptions
En droit français, l’exception au profit des œuvres transformatrices n’existe pas, même si une partie minoritaire de la doctrine française souhaiterait voir émerger cette exception, sans toutefois y parvenir. Il faut dire qu’à l’opposé du spectre du fair use américain ouvert et jurisprudentiel, se trouve le droit d’auteur français très protecteur dont les exceptions sont enserrées dans une liste légale, fermées et strictement limitées. Issues de la transposition de Directives européennes et définies en droit interne par le législateur français, elles sont principalement énumérées à l’article L.122-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Parmi celles-ci, celle qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de la question de la réappropriation, « La parodie, le pastiche, et la caricature, compte tenu des lois du genre » (L.122-5-4° du CPI).
Cette exception permettant la réappropriation d’une œuvre existante dans le cadre d’une parodie, d’un pastiche et d’une caricature est d’interprétation stricte. Ainsi, le juge ne peut créer de nouvelle exception, ni les élargir par analogie. Pour entrer dans le cadre de l’exception de parodie, il faut pouvoir démontrer l’intention humoristique de son auteur, ce qui par exemple aurait été problématique si l’affaire américaine citée précédemment, the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Lynn Goldsmith, avait été jugée en France.
Très clairement, la série Prince n’aurait pas pu rentrer dans l’exception de parodie au sens du droit français et européen. Et ce même si, dans un raisonnement spéculatif, on aurait pu arguer que la démarche d’Andy Warhol questionnait de manière grinçante nos rapports à la célébrité. Cela ne saurait suffire : en droit français, la critique doit être humoristique, ni trop grossière, ni trop subtile, elle devrait être « burlesque » si l’on s’en tient à la jurisprudence européenne (CJUE, gde ch., 3 septembre 2014, aff. C-201/13, Deckmyn), ce qui restreint évidemment le champ des possibles en termes de création sur une œuvre existante.
Ainsi, dans une affaire bien réelle, l’artiste Jeff Koons s’est vu interdire de reproduire une œuvre contrefaisante – une sculpture reproduisant une photographie existante de deux enfants nus – pour laquelle il invoquait en défense l’exception de parodie. En l’espèce, la Cour a considéré que cette exception ne pouvait être utilement invoquée :
« la parodie doit aussi présenter un caractère humoristique, faire œuvre de raillerie ou provoquer le rire, condition que ne caractérise ni ne revendiquent Jeff Koons et la société Jeff Koons LLC, la différence entre les messages transmis par les deux œuvres ne répondant pas à cette condition de l’exception de parodie » (CA Paris, pôle 5-1, 17 déc. 2019, n° 17/09695, Koons c/ Bauret).
Les exceptions au droit d’auteur étant si restrictives, on aurait pu espérer que la liberté de création puisse trouver sa marge de manœuvre dans le test tiré de l’affaire Klasen de l’analyse in concreto de l’équilibre entre droit d’auteur et autres droits fondamentaux telle que la liberté d’expression (Cass. 1ère Civ, 15 mai 2015, n°13/27.391). Ce n’est malheureusement pas le cas puisque le droit d’auteur prenant le dessus sur la liberté d’expression, il est demandé au défendeur de démontrer que la contrefaçon était une figure imposée, voire rendue nécessaire par la liberté d’expression (CA Versailles, 1ère Ch. 1ère Sect., 16 mars 2018, n°15/06029)… Or, cette démonstration est rendue difficile par l’acte de création lui-même : comment démontrer l’impérieuse nécessité de choisir l’utilisation de telle œuvre préexistante plutôt qu’une autre ? C’est tout l’enjeu de la nécessité créative – plus que de liberté – auquel sont confrontés les auteur•rices qui souhaitent aujourd’hui s’inscrire dans l’histoire de l’art.