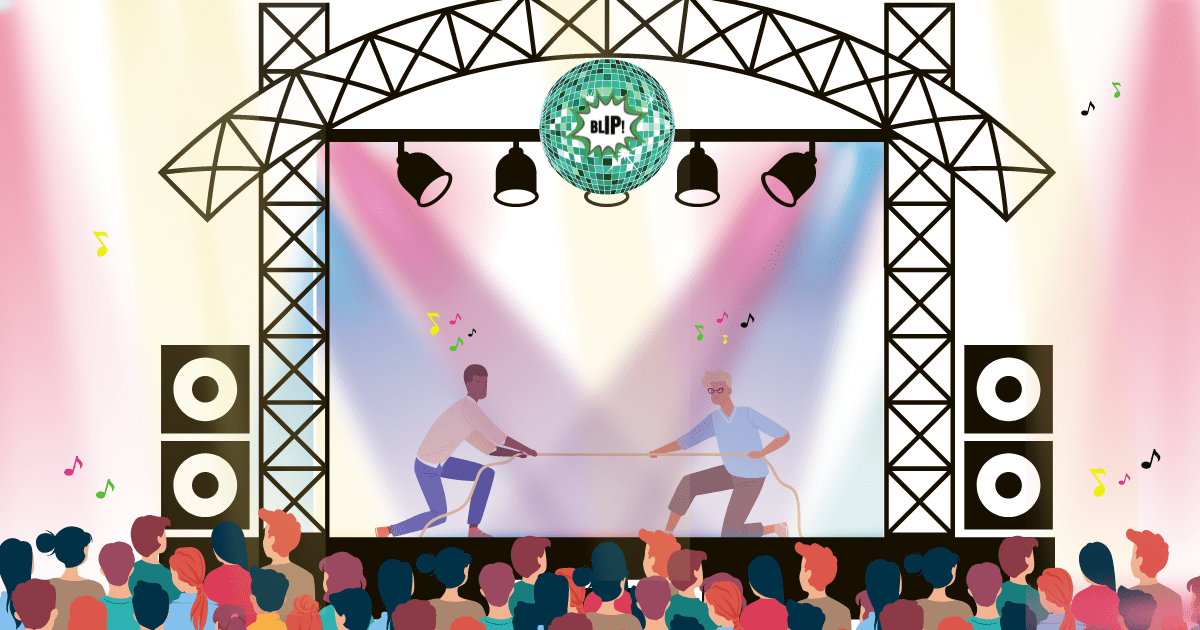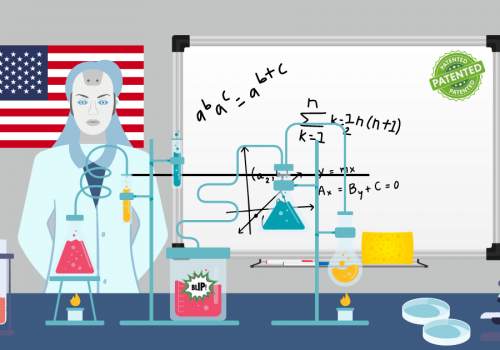Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 février 2024, n° 22-18.120
Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 février 2024, n° 22-18.120
Par Alexis Boisson, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Montpellier – Centre du droit de l’entreprise (CDE).
La Cour de cassation livre un arrêt aussi intéressant que laconique sur la question du formalisme contractuel en droit d’auteur. La décision rendue n’est certes pas surprenante : elle creuse un sillon ancien. Mais dans un droit des contrats d’auteur en pleine évolution, c’est précisément sa permanence qui attire notre attention.
La Société Chris Music, éditrice et productrice de musique, détient les droits patrimoniaux d’auteur sur la chanson « Partenaire Particulier », ainsi que les droits voisins correspondants. La société Musiques & Solutions intervient quant à elle dans le placement de musiques. Les deux sociétés s’entendent sur l’utilisation d’extraits du fameux « tube » dans la bande sonore du film Alibi.com. Cependant, après de longs échanges, un désaccord apparaît in extremis quant à la mention destinée à figurer au générique du film. La société éditrice émet le souhait de voir sa dénomination sociale y figurer en lieu et place de celle de la société prestataire. Elle ne signera jamais le contrat. Le film sort et la société Chris Music, les co-auteurs et interprètes assignent la société Musiques & Solutions ainsi que le producteur du film en suppression des extraits et mention et en indemnisation, sur le fondement de leurs droits patrimoniaux et moraux. Ces prétentions seront sèchement rejetées en appel (CA Paris, 11 mars 2022, n°20/09922) puis en cassation.
Cette affaire offre des précisions intéressantes au sujet du droit moral au respect de l’œuvre : le procédé de la synchronisation ne caractérise pas en soi une atteinte. Mais c’est une autre question qui retiendra notre attention : une société titulaire de droits d’auteur n’ayant pas signé le « Contrat de licence non exclusive » qui lui est soumis peut-elle néanmoins être considérée comme ayant consenti ?
Après récit complet des circonstances de la négociation, la Cour d’appel estimait que la société titulaire avait bien « donné son accord ». Cette dernière invoquait au contraire une méconnaissance des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI relatifs à l’exigence d’un écrit. Mais son pourvoi est rejeté par notre arrêt :
« 5. Selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
6. Dès lors que ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants, elles sont inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d’exploitation, avec la société Musiques & Solutions. ».
La Cour de cassation confirme la vigueur d’un principe (I), dont la simplicité apparente appelle néanmoins un minimum de vigilance (II). Un dernier point plus prospectif montrera que cet arrêt n’épuise pas la matière (III).
I – Un point confirmé : le formalisme ne profite qu’à l’auteur contractant
À l’instar d’autres dispositions destinées à protéger l’auteur, il est admis que l’exigence d’un contrat écrit à titre de preuve (L.131-2 CPI) et celle, complémentaire, du contenu détaillé de cet écrit aux fins de validité (art. L. 131-3)
ne concernent que les contrats conclus par l’auteur à propos de sa propriété littéraire et artistique. Autrement dit, seuls sont concernés les « contrats d’auteur ». Les contrats de droit d’auteur subséquents entre exploitants, parfois improprement dénommés « sous-cessions », demeurent soumis au droit commun. La solution est admise depuis le fameux arrêt Perrier (Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, 91-11.241). Elle est tenue pour constante (v. par ex. Cass., ch. com., 5 novembre 2002, 01-01.926), généralement au visa de l’article L131-3 du CPI. Notre arrêt mentionne les deux articles.
Le principe réaffirmé est lourd de sens : le formalisme n’est pas une « servitude » qui grève l’œuvre, comme avait pu le défendre Desbois. C’est une mesure de protection de l’auteur, partie faible au contrat.
Mais cet arrêt ne se contente pas de consolider l’acquis. Il vient aussi effacer un doute. Il est une des rares décisions à se prononcer sur la nouvelle rédaction de l’article L131-2 du CPI. Depuis la loi n° 2016-925, dite « Création », du 7 juillet 2016, un alinéa est ajouté à la liste des contrats à établir par écrit : « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur ». Cette formulation abstraite : « des droits d’auteur », alors que l’article L. 131-3 évoque : « les droits de l’auteur » a pu déconcerter, car elle semble bien englober tout contrat dont l’objet est l’œuvre protégée par le droit d’auteur, y compris lorsque l’auteur n’est plus en présence. Il était donc réaliste de craindre que là où la loi ne fait plus de différence, le juge n’en fasse pas davantage.
Par ailleurs, chacun sait qu’en droit d’auteur le législateur ne fait pas grand cas de la distinction entre cession et licence, pourtant reconnue en droit de l’Union Européenne. On pouvait donc craindre que tous les contrats de la matière soient englobés dans cette mystérieuse « transmission ». Or, de nombreuses entreprises se cèdent ou concèdent des droits entre elles, sans davantage d’égard pour le vocabulaire et sans contrat écrit. La fin de la jurisprudence Perrier était donc dans la balance. Ce n’est pourtant pas ce qui s’est produit. Dans cet arrêt, les juges réservent toujours au seul auteur le bénéfice du formalisme censé le protéger. (v. A. Boisson, L’article L131-2 du CPI : pilier du droit d’auteur et monument d’incertitudes, in Le Code de la propriété intellectuelle en dix articles, Dir. A. Favreau, Dalloz, 2021, Coll. Thèmes et commentaires, p.83 hal.science/hal-03501031).
II – Un point de vigilance : au-delà du formalisme, le consentement
Quand bien même l’instrumentum n’avait pas été signé, les parties s’étaient entendues sur le negotium. Les réserves tardives de la société Chris Music n’étaient « pas sérieuses », estime la cour d’appel. Ainsi : « sur le principe et sur les modalités de son autorisation d’utilisation de la chanson (…) Le nombre d’extraits, la durée des extraits, le montant de la rémunération, et, en définitive, les limites et les conditions » le consentement des parties était acquis, aurait-on envie de dire : sur la chose et sur le prix.
Mais ces évidences, non démenties par la Cour de cassation, devraient être autant de points de vigilance. Que la conclusion du contrat et l’administration de sa preuve puissent se faire sans document signé par chaque partie est une chose… Mais cela ne veut pas dire – en droit d’auteur comme ailleurs – que le consentement est « présumé » ou purement tacite. Rappelons que chacun peut rompre les négociations précontractuelles. Au pire, l’auteur de la rupture aura abusé de sa liberté et engagera sa responsabilité extracontractuelle. Mais le contrat ne sera pas conclu pour autant (art. 1112 C. civ.).
Les débats pointus sur le formalisme contractuel ne doivent pas faire perdre de vue la question du consentement. En l’espèce, il a été jugé que ce consentement était suffisamment caractérisé, soit. Et il est vrai que la rupture abusive des négociations n’était pas soulevée.
On rappellera simplement que l’absence de consentement en cas de contrat non signé reste la norme, même lorsque tout porte à croire que l’auteur a toléré la situation (pour un autre cas de synchronisation : Cass. 1re civ. 13 novembre 2014, 13-22.401 ; pour un cas intéressant car rendu au visa du seul du Code civil : Cass. 1re civ. 4 octobre 2017, n° 16-10.411). C’est donc une question d’espèce que l’on se gardera de généraliser.
III – Un point de prospective : le « cessionnaire », une catégorie à affiner ?
Sont donc dispensés de formalisme les contrats conclus par « les cessionnaires avec des sous-exploitants ». Mais qui est, au juste, ce « cessionnaire » ? On pense au premier exploitant auquel l’auteur a confié ses droits : ici notre éditeur de musique ; ailleurs : un employeur, un commanditaire…
Or, il est intéressant de relire cette jurisprudence à la lumière de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Bien qu’il ne se prononce pas sur la question du formalisme, ce texte affirme l’objectif d’une meilleure protection des auteurs. Le considérant n°72 justifie cette démarche en ces termes très généraux : « Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par l’intermédiaire de leurs propres sociétés (…)». L’affirmation n’est pas si anodine : l’auteur devrait être protégé même lorsque, ayant cédé ses droits à « sa » société, c’est à travers elle qu’il confie son œuvre à de « véritables » exploitants. (NB : le texte ne fait pas référence aux organismes de gestion collective).
Travailleur indépendant, l’auteur peut opter pour un statut d’entrepreneur individuel. Il peut également créer une société dont il sera l’associé unique et le dirigeant. Des co-auteurs ou ayants droit peuvent également opter pour une société comme alternative à l’indivision. Ce choix d’ordre patrimonial, fiscal, purement pratique, ne devrait pas priver l’auteur des dispositions légales protectrices qui lui reviennent. Un principe de neutralité du statut professionnel de l’auteur quant à l’application des dispositions protectrices du Code de la propriété intellectuelle serait conforme à l’esprit des textes. Quels en seraient alors les contours exacts ? Une chose est sûre : chaque nouvel arrêt sur la question du formalisme soulève autant de questions qu’il n’offre de réponses !
Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 février 2024, n° 22-18.120
Par Alexis Boisson, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Montpellier – Centre du droit de l’entreprise (CDE).